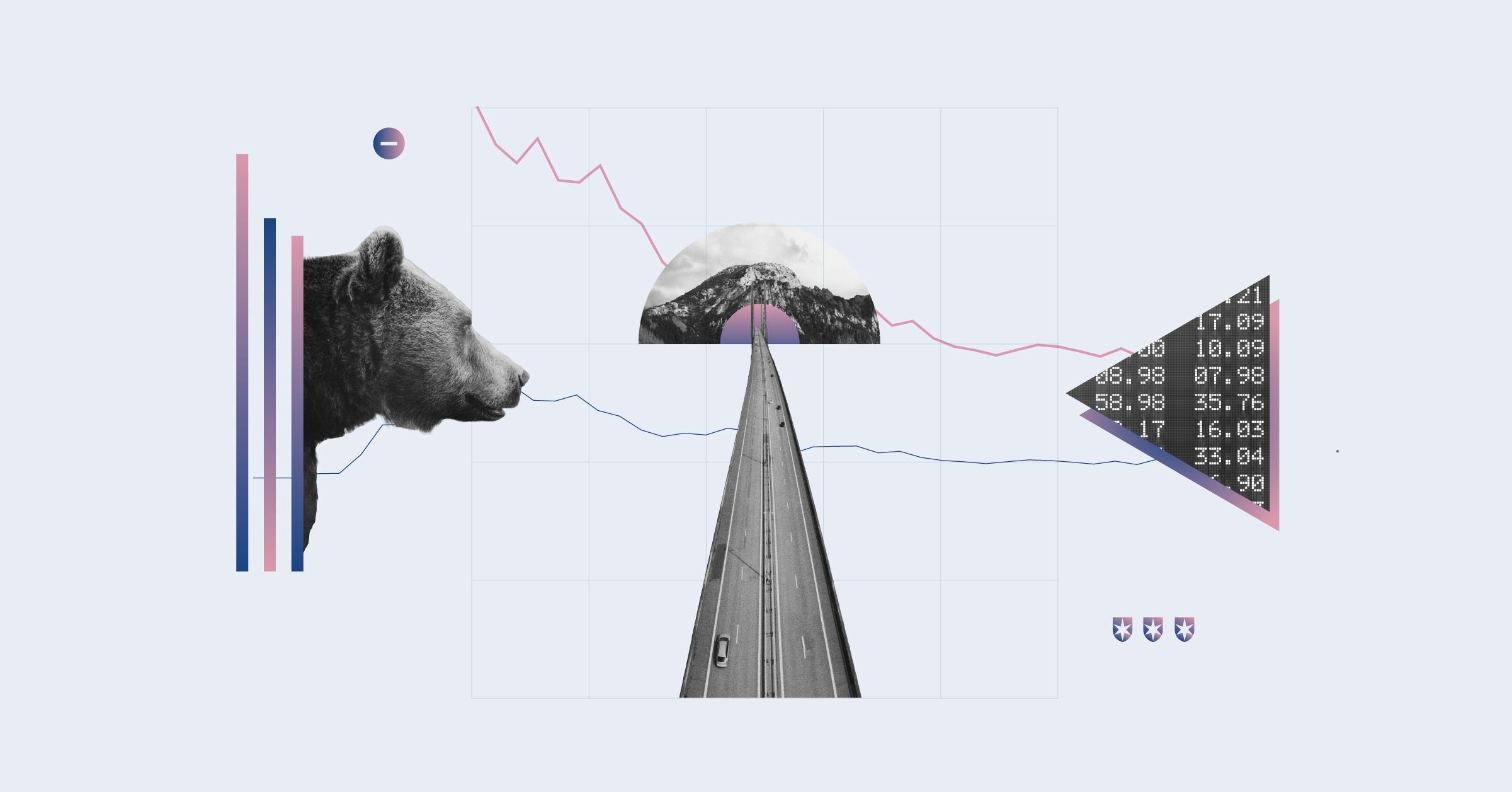Votre livre établit un véritable florilège des biais qui guettent les investisseurs, quel est celui qui vous semble le plus courant ?
Il y a un biais qui incontestablement se détache du lot, c’est l’aversion des investisseurs aux pertes : on hésite à sanctionner une perte en coupant une ligne. Concrètement cela signifie que l’on garde plus longtemps une position perdante qu’une position gagnante. On tend à prendre ses bénéfices lorsqu’ils se présentent mais on pense pouvoir se refaire en cas de perte.
Il est vrai que l’adage dit "tant qu’on n’a pas vendu on n’a pas perdu", mais il ne correspond pas à la réalité ! Si vous étiez une entreprise, en fin d’année vous devriez constater une perte. Statistiquement, ce biais conduit en fin de compte à obtenir des portefeuilles avec des performances médiocres.
Est-ce que ce biais n’est pas un peu l’apanage des investisseurs individuels qui ont parfois tendance à trop faire confiance à leur intuition ?
Il est vrai que ce biais s’explique en bonne partie par l’ego, la tendance à être trop confiant en soi. Il touche aussi les professionnels de la finance comme les traders ou les gérants de fonds, mais l’expérience permet de l’atténuer. On constate que 35% environ des professionnels de la finance présentent ce biais contre une proportion de l’ordre de 70% chez les investisseurs individuels.
L’excès de confiance se manifeste en ce qui concerne les placements financiers comme dans les autres circonstances de la vie. C’est ce qui amène à penser par exemple que l’on est meilleur conducteur que son voisin, avec de meilleurs réflexes au volant. Une des conséquences les plus directes de l’excès de confiance est l’excès de trading avec un taux de rotation important des portefeuilles. Là encore, cet excès de trading pèse sur la performance moyenne des portefeuilles.
Quel autre biais important menace l’investisseur ?
Le biais de la représentativité est lui aussi très pernicieux. Il se manifeste en particulier lorsque les investisseurs s’intéressent aux performances passées d’un placement. On tend alors à ne regarder que les performances récentes, les plus proches de nous, sur un trimestre ou 1 an. On sureprésente les performances et information d’une courte période.
Ce biais s’accompagne souvent d’une autre biais, celui de la confirmation : on ne regarde que les informations qui confirment nos croyances et nos choix.
Mais vous-même, qui avez beaucoup travaillé sur la psychologie de l’investissement, gardez-vous des biais ?
Oui, malgré tout je garde un biais national, c'est-à-dire que j’ai tendance à croire que je comprends mieux ce qui se passe sur des valeurs françaises qu’avec des valeurs étrangères. Cela fait partie du biais de familiarité : c’est comme le salarié qui achète des actions de son employeur en pensant être plus à même d’apprécier le titre. Ce n’est pratiquement jamais le cas. Dans cette situation, les gens anticipent des rendements supérieurs à ce qu’il est légitime d’attendre et perçoivent un niveau de risque inférieur à ce qu’il est en réalité.
Le biais national est un biais que l’on retrouve fréquemment chez les gérants de fonds qui sont sensés investir en actions européennes : ils sont souvent surinvestis sur le marché français.
Quels conseils pouvez-vous donner aux investisseurs
D’abord faire le monitoring de ses décisions, c'est-à-dire les analyser après coup pour voir si elles étaient fondées. Mais il faut le faire par écrit sinon on court le risque de tomber dans le biais de confirmation. Donc lorsque l’on prend une décision d’investissement, il faut noter les raisons que l’on a eu d’acheter ou de vendre une valeur afin de garder une trace objective.
D’autre part, il faut essayer d’élargir son champ d’analyse afin de bien appréhender son portefeuille comme un tout, pas comme une succession de titres. On a souvent une vision biaisée du risque : on considère par exemple que les actions des marchés émergents sont risquées, mais elles peuvent apporter de la diversification à un portefeuille investi en actions européennes et donc faire baiser le niveau de risque global du portefeuille.
Vous venez de publier votre deuxième livre consacré à la finance comportementale, comment expliquez-vous que le sujet soit encore peu connu en France ?
C’est en effet assez étonnant alors que cette discipline est très connue aux Etats-Unis, au Royaume Uni, en Allemagne et dans de nombreux autres pays. Mais je pense que le sujet est très prometteur en France, l’accueil a été excellent tant au niveau des investisseurs individuels que des professionnels et des universitaires.
La psychologie de l’investisseur est une discipline qui est maintenant bien établie. Elle a commencé à se diffuser à partir des années 80 et a connu un coup d’accélérateur dans les années 90. Curieusement, alors que l’on trouve en France de nombreux économistes et chercheurs de haut niveau et souvent novateurs en matière de finance il est surprenant que cette branche n’ait pas été plus étudiée dans l’Hexagone.